Lettre 12 - Spinoza à Louis Meyer (20 avril 1663)
Lettre sur l’Infini.
Lisez l’Explication de la Lettre sur l’Infini (Lettre XII, à Louis Meyer), par M. Gueroult dans Spinoza I, Dieu (Ethique, I), Aubier-Montaigne, 1968, p. 500 et suiv.
Au très savant et très sage Louis Meyer,
Docteur en philosophie et médecine,
Benoît de Spinoza.
Mon excellent ami,
J’ai reçu de vous deux lettres, l’une, du 11 janvier, qui m’a été remise par notre ami NN., l’autre, du 26 mars, envoyée à Leyde par un ami inconnu. L’une et l’autre m’ont fait grand plaisir, tout d’abord parce que j’ai connu par elles que vos affaires allaient tout à fait selon vos désirs et que vous pensiez souvent à moi. Je vous sais beaucoup de gré, en outre, de votre bienveillance envers moi et des marques de considération que vous me donnez. Je vous prie de croire que je vous suis également tout dévoué et que, si l’occasion s’en présente, je m’efforcerai de le montrer autant que mes faibles forces le permettront. Pour commencer je m’efforcerai de répondre aux questions posées dans vos lettres. Vous me demandez ce que la réflexion m’a conduit à penser de l’Infini ; je vous le communiquerai très volontiers.
Le problème de l’Infini a toujours paru à tous très difficile et même inextricable, parce qu’on n’a pas distingué ce qui est infini par une conséquence de sa nature ou par la vertu de sa définition et ce qui n’a point de limite non par la vertu de son essence mais par celle de sa cause. Et aussi pour cette raison qu’on n’a pas distingué entre ce qui est dit infini parce que sans limites, et une grandeur dont nous ne pouvons déterminer ou représenter les parties par aucun nombre, bien que nous en connaissions la valeur la plus grande et la plus petite. Et enfin parce qu’on n’a pas distingué entre ce que nous pouvons seulement concevoir par l’entendement, mais non imaginer, et ce que nous pouvons aussi nous représenter par l’imagination. Si l’on avait tenu compte de toutes ces distinctions, on n’aurait pas été accablé sous le poids de tant de difficultés. On aurait clairement connu quel Infini ne peut être divisé en parties ou est sans parties, quel au contraire est divisible, et cela sans qu’il y ait contradiction. On aurait connu, en outre, quel Infini peut être sans difficulté conçu comme plus grand qu’un autre Infini, quel au contraire ne peut l’être, et c’est ce que je vais montrer clairement ci-après. Auparavant toutefois il me faut traiter en quelques mots de quatre sujets : la Substance, le Mode, l’Éternité, la Durée.
Au sujet de la Substance, voici ce que je veux que l’on considère : 1° l’existence appartient à son essence, c’est-à-dire qu’il suit qu’elle existe de sa seule essence et définition ; si ma mémoire ne me trompe, je vous ai démontré cela de vive voix et sans le secours d’autres propositions. 2e point qui découle du premier : il n’existe pas plusieurs substances de même nature, mais une substance unique. 3e point enfin : une substance ne peut être conçue autrement que comme infinie. J’appelle Modes, d’autre part, les affections d’une Substance, et leur définition, n’étant pas celle d’une substance, ne peut envelopper l’existence. C’est pourquoi, bien que les Modes existent, nous pouvons les concevoir comme n’existant pas, d’où suit que, si nous avons égard à la seule essence des modes et non à l’ordre de toute la nature, nous ne pouvons conclure de ce que présentement ils existent, qu’ils existeront par la suite ou qu’ils n’existeront pas, qu’ils ont existé antérieurement ou n’ont pas existé. On voit clairement par là que nous concevons l’existence des Modes comme entièrement différente de celle de la Substance. D’où se tire la différence entre l’Éternité et la Durée ; sous le concept de Durée nous ne pouvons concevoir que l’existence des modes, tandis que celle de la Substance est conçue comme Éternité, c’est-à-dire comme une jouissance infinie de l’existence ou de l’être.
De tout cela il ressort clairement que si, comme il arrive bien souvent, nous avons égard à la seule essence des modes et non à l’ordre de la nature, nous pouvons fixer à volonté et cela sans porter la moindre atteinte au concept que nous en avons, l’existence et la durée, la concevoir plus grande ou plus petite et la diviser en parties. Sur l’Éternité au contraire et sur la Substance puisqu’elles ne peuvent être conçues autrement que comme infinies, aucune de ces opérations ne saurait s’exécuter, sans que le concept même que nous avons d’elles fût détruit. Ceux-là donc tiennent de vains propos, pour ne pas dire qu’ils déraisonnent, qui pensent que la Substance étendue est composée de parties, c’est-à-dire de corps réellement distincts les uns des autres. C’est comme si, en joignant des cercles, en les accumulant, l’on s’efforçait de composer un triangle ou un carré ou n’importe quoi d’une essence tout opposée à celle du cercle. Tout ce fatras d’arguments par lesquels les philosophes veulent habituellement montrer que la Substance étendue est finie, s’effondre de lui-même : tous ces discours supposent une Substance corporelle composée de parties. De la même manière d’autres auteurs, après s’être persuadés que la ligne se compose de points, ont pu trouver beaucoup d’arguments pour montrer qu’une ligne n’est pas divisible à l’infini.
Si cependant vous demandez pourquoi nous sommes si naturellement portés à diviser la substance étendue, je répondrai : c’est parce que la grandeur est conçue par nous de deux façons : abstraitement ou superficiellement ainsi que nous la représente l’imagination avec le concours des sens, ou comme une substance, ce qui n’est possible qu’au seul entendement. C’est pourquoi, si nous considérons la grandeur telle qu’elle est pour l’imagination, ce qui est le cas le plus fréquent et le plus aisé, nous la trouverons divisible, finie, composée de parties et multiple. Si, en revanche, nous la considérons telle qu’elle est dans l’entendement, et si la chose est perçue comme elle est en elle-même, ce qui est très difficile, alors, ainsi que je vous l’ai suffisamment démontré auparavant, on la trouve infinie, indivisible et unique.
Maintenant, du fait que nous pouvons à volonté délimiter la Durée et la Grandeur, quand nous concevons celle-ci en dehors de la Substance et faisons abstraction en celle-là de la façon dont elle découle des choses éternelles, proviennent le Temps et la Mesure. Le Temps sert à délimiter la Durée, la Mesure, à délimiter la Grandeur de telle sorte que nous les imaginions facilement, autant que la chose est possible. Puis, du fait que nous séparons de la Substance même les affections de la Substance et les répartissons en classes pour les imaginer aussi facilement qu’il est possible, provient le Nombre à l’aide duquel nous arrivons à des déterminations précises. On voit clairement par là que la Mesure, le Temps et le Nombre ne sont rien que des manières de penser ou plutôt d’imaginer. Il n’est donc pas étonnant que tous ceux qui ont entrepris de concevoir la marche de la nature à l’aide de notions semblables et encore mal comprises, se soient embarrassés dans des difficultés inextricables dont ils n’ont pu se tirer qu’en brisant tout et en admettant les pires absurdités. Comme il y a beaucoup de choses, en effet, que nous ne pouvons saisir que par le seul entendement, non du tout par l’Imagination, et telles sont, avec d’autres, la Substance et l’Éternité, si l’on entreprend de les ranger sous des notions comme celles que nous avons énumérées, qui ne sont que des auxiliaires de l’Imagination, on fait tout comme si l’on s’appliquait à déraisonner avec son imagination. Les modes mêmes de la Substance ne pourront jamais être connus droitement, si on les confond avec ces Êtres de raison que sont les auxiliaires de l’imagination. Quand nous faisons cette confusion, en effet, nous les séparons de la Substance et faisons abstraction de la manière en laquelle ils découlent de l’Éternité, c’est-à-dire que nous perdons de vue les conditions sans lesquelles ces modes ne peuvent être droitement connus.
Pour le voir plus clairement, prenez cet exemple : dès que l’on aura conçu abstraitement la Durée et que, la confondant avec le Temps, on aura commencé de la diviser en parties, il deviendra impossible de comprendre en quelle manière une heure, par exemple, peut passer. Pour qu’elle passe, en effet, il sera nécessaire que la moitié passe d’abord, puis la moitié du reste et ensuite la moitié de ce nouveau reste, et retranchant ainsi à l’infini la moitié du reste, on ne pourra jamais arriver à la fin de l’heure. C’est pour cela que beaucoup, n’ayant pas accoutumé de distinguer les êtres de raison des choses réelles, ont osé prétendre que la Durée se composait d’instants et, de la sorte, pour éviter Charybde, ils sont tombés en Scylla. Car il revient au même de composer la Durée d’instants et de vouloir former un nombre en ajoutant des zéros.
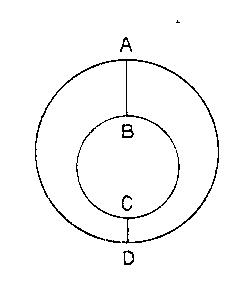
On voit encore par ce qui vient d’être dit, que ni le nombre ni la mesure ni le temps, puisqu’ils ne sont que des auxiliaires de l’imagination, ne peuvent être infinis, sans quoi le nombre ne serait plus le nombre, ni la mesure, la mesure, ni le temps, le temps. D’où l’on voit clairement pourquoi beaucoup de gens, confondant ces trois êtres de raison, avec les choses réelles dont ils ignoraient la vraie nature, ont nié l’Infini. Mais pour mesurer la faiblesse de leur raisonnement, rapportons-nous-en aux mathématiciens qui ne se sont jamais laissé arrêter par des arguments de cette qualité, quand ils avaient des perceptions claires et distinctes. Outre, en effet, qu’ils ont trouvé beaucoup de grandeurs qui ne se peuvent exprimer par aucun nombre, ce qui suffit à montrer l’impossibilité de tout déterminer par les nombres, ils connaissent aussi des grandeurs qui ne peuvent être égalées à aucun nombre mais dépassent tout nombre assignable.
Ils n’en concluent pas cependant que de telles grandeurs dépassent tout nombre par la multitude de leurs parties ; cela résulte de ce que, à leurs yeux, ces grandeurs ne se prêtent, sans une contradiction manifeste, à aucune détermination numérique. Par exemple, la somme des distances inégales comprises entre deux cercles AB et CD et celle des variations que la matière en mouvement peut éprouver dans l’espace ainsi
délimité, dépassent tout nombre assignable. Cela ne résulte pas de la grandeur excessive de cet espace, car, si petit que nous le supposions, la somme des distances inégales dépassera toujours tout nombre. Cela ne résulte pas non plus, comme il arrive dans d’autres cas, de ce que nous n’avons pas pour ces distances de maximum et de minimum car, dans cet exemple, il y a un maximum AB et un minimum BC ; cela résulte seulement de ce que la nature de l’espace compris entre deux cercles non concentriques n’admet pas un nombre déterminé de distances inégales. Si donc l’on voulait déterminer par le nombre la somme de toutes ces distances inégales, il faudrait faire en même temps qu’un cercle ne fût plus un cercle.
De même, pour revenir à notre sujet, si l’on voulait déterminer tous les mouvements de la matière qui ont eu lieu jusqu’à l’instant présent, en les ramenant ainsi que leur durée à un nombre et à un temps déterminés, ce serait comme si l’on s’efforçait de priver de ses affections la Substance corporelle que nous ne pouvons concevoir autrement que comme existante, et de faire qu’elle n’ait pas la nature qui est la sienne. Je pourrais démontrer cela clairement, ainsi que beaucoup d’autres points que j’ai touchés dans cette lettre, si je ne le jugeais inutile.
Dans tout ce qui précède on voit clairement que certaines choses sont infinies par leur nature et ne peuvent être conçues en aucune façon comme finies ; que certaines choses le sont par la vertu de la cause dont elles dépendent, et que toutefois, quand on les conçoit abstraitement, elles peuvent être divisées en parties et être regardées comme finies, que certaines autres enfin peuvent être dites infinies ou, si vous l’aimez mieux, indéfinies, parce qu’elles ne peuvent être égalées par aucun nombre, bien qu’on les puisse concevoir comme plus grandes ou plus petites ; il n’est donc pas nécessaire que des choses qu’on ne peut égaler par un nombre soient égales, comme on le voit assez par l’exemple donné ci-dessus et par beaucoup d’autres.
Je vous ai enfin, en peu de mots, mis sous les yeux, sauf erreur, la cause des erreurs et des confusions qui se sont produites au sujet de cette question de l’Infini et j’ai expliqué ces erreurs de telle sorte qu’il n’y ait plus, à ce que je pense, une seule question -relative à l’Infini que je n’aie touchée ou dont la solution ne se déduise très facilement de mon exposé. Je ne juge donc pas qu’il vaille la peine de vous retenir plus longtemps sur ce sujet.
Je voudrais cependant noter encore que les Péripatéticiens modernes ont mal compris, à ce que je crois, une démonstration donnée par les Péripatéticiens anciens pour tenter d’établir l’existence de Dieu. Telle, en effet, que je la trouve dans un certain auteur juif appelé Rab Ghasdaj, voici comment elle s’énonce. S’il existe un progrès à l’infini des causes dans la nature, tout ce qui existe sera l’effet d’une cause. Or, à aucune chose qui dépend d’une cause, il n’appartient d’exister par la vertu de sa nature. Donc il n’existe dans la nature aucune chose à l’essence de laquelle il appartient d’exister nécessairement. Mais cette conclusion est absurde, donc la supposition d’où on la déduit l’est aussi. La force de l’argument ne réside pas en ce qu’il est impossible qu’un Infini en acte soit donné ou encore un progrès des causes à l’infini, mais seulement dans cette supposition que les choses qui n’existent pas nécessairement par nature ne sont pas déterminées à exister par une chose qui, elle, existe.
Je devrais passer maintenant, étant pressé par le temps, à votre deuxième lettre, mais il me sera plus facile de répondre aux questions qu’elle contient, quand vous m’aurez honoré d’une visite. Je vous prie donc de venir le plus tôt possible, car le temps de mon départ approche. J’en resterai là. Portez-vous bien et n’oubliez pas celui qui se dit votre...
Rijnsburg, le 20 avril 1663 .

