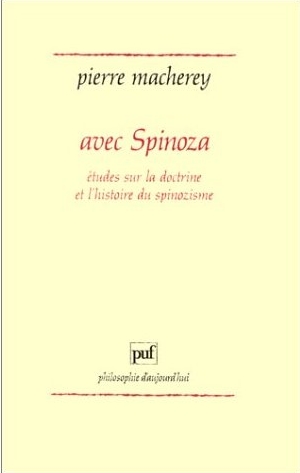Pierre Macherey
Hegel ou Spinoza, de Pierre Macherey.
– Broché : 263 pages
– Editeur : Maspero (1979 ; La Découverte ; Édition : 2e (1990)
4è de couverture
Hegel ou Spinoza, et non Hegel et Spinoza : la question n’est pas ici de procéder à la comparaison entre des auteurs et des systèmes, enfermés une fois pour toutes dans les limites de leur sens, qu’on pourrait tout au plus identifier et exhiber dans un commentaire purement théorique. Ce qui vient au premier plan, c’est leur active confrontation, celle de doctrines irréductibles. Entre Hegel et Spinoza, quelque chose se passe, et c’est la connaissance de cet événement qui peut nous faire avancer dans la connaissance de l’histoire de la philosophie, c’est-à-dire dans la connaissance de ce que c’est pour la philosophie que d’avoir une histoire. Hegel a lu Spinoza, et il ne l’a pas compris. Ce fait bien connu présente quelques particularités étonnantes. D’abord, l’étrange fascination que Hegel éprouve à l’égard de Spinoza, dont il fait son principal interlocuteur philosophique. Surtout, il y a ceci : en dépit de la méprise en quelque sorte systématique commise par Hegel sur la lettre du spinozisme, il y a une reconnaissance paradoxale de la position singulière que celui-ci occupe, à laquelle Hegel oppose une constante dénégation. Tout se passe comme si Hegel avait vu dans Spinoza la limite de son propre système. De ce point de vue, les perspectives traditionnelles se renversent : Hegel lecteur de Spinoza, c’est aussi et surtout Spinoza lecteur de Hegel. On dit souvent, pour expliquer ou excuser les erreurs de lecture de Hegel, qu’il a mieux compris Spinoza que celui-ci ne s’était compris lui-même et qu’il a lu dans son texte au-delà de ce qui y était écrit. Et si c’était Spinoza qui déjà avait mieux compris Hegel.
Table des matières
Préface à la seconde édition
L’alternative
I. Hegel lecteur de Spinoza
- Le point de vue de la substance
– Une philosophie du commencement
– La reconstruction du système
II. More geometrico
– Hegel et la méthode
– La réévaluation spinoziste de la méthode
– La connaissance par les causes
– Idée adéquate et idée inadéquate
III. Le problème des attributs
– L’ambiguïté de la notion d’attribut
– La réalité des attributs
– La diversité des attributs
– Constitution de la substance dans ses attributs
– L’ordre et la connexion des « choses »
– L’erreur de Hegel sur les attributs
IV. Omnis determinatio est negatio
– Le négativisme de Spinoza
– Une dialectique impuissante
– Le fini et l’infini
– La détermination
– Les modes infinis
– Non opposita sed diversa
– Les essences singulières
– Force et conatus
– La téléogie.
Avec Spinoza. Études sur la doctrine et l’histoire du spinozisme, de Pierre Macherey.
– Broché : 271 pages
– Editeur : Presses Universitaires de France - PUF (1 novembre 1992)
– Collection : Philosophie d’aujourd’hui
4è de couverture
Plus qu’aucune autre, liée à un moment, enfoncée dans un lieu et un temps - la Hollande de la seconde moitié du XVIIè siècle -, la philosophie de Spinoza reste plus que jamais « moderne ». Spinoza doit donc être lu « au présent », comme un philosophe qui se comprend et agit ici et aujourd’hui, tant il permet de reformuler des problèmes que nous nous posons. C’est ce que montre le réexamen de quelques « points de doctrine », des paradoxes de la connaissance immédiate à la question de la fin de l’histoire en passant par la signification éthique du De Deo.
Aussi bien la pensée de Spinoza ne s’est-elle jamais offerte qu’à travers des rapports historiques biaisés, qui en ont livré autant d’esquisses effacées aussitôt que tracées, dont le répertoire reste ouvert. Les figures ici évoquées, de son effet sur la pensée classique (Hobbes, Pascal, Louis Meyer, Condillac) et sur la pensée moderne, de Hegel à Heidegger en passant par Freud et Russell, d’Adorno à Negri en passant par Deleuze et Foucault, suggèrent cette superposition de « traits » qui, sans accéder à la netteté idéale d’un dessin définitif, témoigne de la dynamique historique que la philosophie spinoziste porte en elle.
Faire de la philosophie « avec Spinoza », c’est habiter cette pensée inquiète d’elle-même. C’est donc à la fois participer en quelque sorte à l’éternité -de cette philosophie-monde et actualiser sa puissance d’énonciation en la rendant effective et présente.
Table des matières
Spinoza au présent
– Sub specie aeternitatis
– La lettre et l’interprétation
– Au nom de Spinoza
– Potentia intellectus
Première Partie POINTS DE DOCTRINE
I Les paradoxes de la connaissance immédiate dans le Court Traité
– « Après avoir démontré précédemment que Dieu est, il est temps maintenant de faire voir ce qu’il est »
– « Nous énoncerons selon la vraie logique d’autres règles de la définition »
II. Action et opération : réflexions sur la signification éthique du De Deo
– Chose libre, chose contrainte
– Agir, opérer
– L’ordre des choses
III. Spinoza, la fin de l’histoire et la ruse de la raison
– Le réalisme politique
– La fin de l’histoire
– La ruse de la raison
Deuxième Partie LECTURES ET CONFRONTATIONS
SPINOZA ET LA PENSÉE CLASSIQUE
I. Sur la différence entre les philosophies de Hobbes et de Spinoza
II. Entre Pascal et Spinoza, : le vide
III. Louis Meyer interprète de l’Ecriture
IV. Condillac critique de Spinoza : une lecture biaisée
SPINOZA ET LA PENSÉE MODERNE
I. Le Spinoza idéaliste de Hegel
II. Note sur le rapport de Spinoza â Freud
III. La dissociation de la métaphysique et de l’éthique (Russell lecteur de Spinoza)
IV. L’actualité philosophique de Spinoza (Heidegger, Adorno, Foucault)
V. Deleuze dans Spinoza
VI. Negri : de la médiation â la constitution (description d’un itinéraire spéculatif)
Introduction à l’Ehique de Spinoza par Pierre Macherey
Introduction à L’éthique de Spinoza. La cinquième partie : Les voies de la libération, de Pierre Macherey.

– Broché : 230 pages
– Editeur : Presses Universitaires de France - PUF (1994)
– Collection : Les grands livres de la philosophie
4è de couverture
Depuis que l’Éthique a été publiée, en 1677, les idées de Spinoza ont suscité, selon les orientations les plus diverses, un intérêt qui ne s’est jamais relâché. Mais ces idées, le plus souvent, ont été considérées pour elles-mêmes, indépendamment du contexte-démonstratif qui soutient leur exposition, en raison du caractère extrêmement technique et de l’aridité de celui-ci.
Dans le présent ouvrage, qui devrait servir d’outil de travail à ceux qui cherchent à avoir un accès plus direct au texte, sont proposées les explications indispensables à une lecture suivie de la cinquième partie de l’ouvrage de Spinoza, où sont exposés les aspects proprement éthiques de sa démarche. En appendice, on trouvera une carte détaillée qui permet de prendre une vue d’ensemble sur les cinq parties de l’Éthique.
Sommaire
– Présentation
Lire l’Éthique de Spinoza
Spinoza dans le texte (Éléments de bibliographie)
Les cinq parties de L’Éthique
– Sujet et composition du de Libertate
– Les axiomes
– Chapitre 1 / Les remèdes aux affects (propositions 1 à 20)
- Le traitement psychophysiologique de l’affectivité : Proposition 1 ; Propositions 2, 3 et 4 ; Propositions 5, 6, 7, 8, 9 et 10.
- L’amour envers Dieu : Propositions 11, 12 et 13 ; Proposition 14 ; Propositions 15 et 16 ; Propositions 17, 18 et 19 ; Proposition 20 ; Scolie de la proposition 20.
– Chapitre 2 / La libération de l’âme et la béatitude (propositions 21 à 42)
- La science intuitive et le point de vue de l’éternité : Propositions 21, 22 et 23 ; Propositions 24 et 25 ; Propositions 26 et 27 ; Propositions 28, 29, 30 et 31.
- L’amour intellectuel de Dieu : Proposition 32 ; Propositions 33, 34 et 37 ; Propositions 35 et 36.
- La libération de l’âme : Propositions 38, 39 et 40.
- L’éthique au quotidien : Propositions 41 et 42.
– Appendice. Une carte de l’Éthique : Partie I (de Deo) ; Partie II (de Mente) ; Partie III (de Affectibus) ; Partie IV (de Servitute) ; Partie V (de Libertate).
Introduction à l’Éthique de Spinoza. La troisième partie : la vie affective, de Pierre Macherey
– Broché : 414 pages
– Éditeur : Presses Universitaires de France - PUF (1995)
– Collection : Les grands livres de la philosophie
4è de couverture
Depuis que l’Éthique a été publiée en 1677, les idées de Spinoza ont suscité, selon les orientations les plus diverses, un intérêt qui ne s’est jamais relâché. Mais ces idées, le plus souvent, ont été considérées pour elles-mêmes, indépendamment du contexte démonstratif qui soutient leur exposition, en raison du caractère extrêmement technique et de l’aridité de celui-ci.
Dans le présent ouvrage, qui devrait servir d’outil de travail à ceux qui cherchent à avoir un accès plus direct au texte, sont proposées les explications indispensables à une lecture suivie de la troisième partie de l’ouvrage de Spinoza, où sont exposées les grandes lignes d’une théorie scientifique de l’affectivité, préalable à la démarche éthique proprement dite.
Sommaire
– Avant-propos
– Sujet et composition du de Affectibus : Un point de vue rationnel sur l’affectivité (titre et préface du de Affectibus) ; Des passions aux affects ; Organisation de la vie affective
– Notions et principes de base (définitions et postulats)
Définitions 1 et 2
Définition 3
Postulats 1 et 2
– Chapitre 1 / Les fondements naturels et les formes élémentaires de la vie affective (propositions 1 à 11)
- Actions et passions de l’âme (prop. 1, 2 et 3)
- Le conatus (prop. 4 à b)
- Les affects primaires (prop. 9 à 11) : a) Le désir et sa double détermination (prop. 9, déf. 1 des affects) ; b) L’alternative de la joie et de la tristesse (prop. 10 et 11, déf. 2 et 3 des affects)
– Chapitre 2 / Les manifestations secondaires de l’affectivité et la formation de la relation d’objet (propositions 12 à 20)
- L’amour et la haine (prop. 12 et 13, déf. 6 et 7 des affects)
- Les mécanismes de l’association et du transfert (prop. 14, 15 et 16, déf. 8 et 9 des affects)
- L’ambivalence affective (prop. 17)
- La projection temporelle de l’affectivité (prop. 18, 19 et 20, déf. 12, 13, 14, 15, 16 et 17 des affects)
– Chapitre 3 / Les figures interpersonnelles de l’affectivité et le mimétisme affectif (propositions 21 à 34)
- Situations duelles et situations triangulaires (prop. 21, 22, 23 et 24, .déf. 18, 19, 23 et 24 des affects)
- Sentiments altruistes et sentiments personnels (prop. 25 et 26, déf. 21, 22, 25, 26, 28 et 29 des affects)
- L’imitation des affects (prop. 27, déf. 33 et 35 des affects)
- Agir sous le regard d’autrui (prop. 28, 29 et 30, déf. 30, 31, 43 et 44 des affects)
- Les effets rétroactifs du mimétisme affectif : désirer et être désiré, aimer et être aimé, haïr et être haï pour soi et pour autrui (prop. 31, 32, 33 et 34)
– Chapitre 4 / Les conflits affectifs (propositions 35 à 47)
- Comment l’amour se transforme en haine (prop. 35, 36, 37 et 38, déf. 32 des affects)
- Ne pas vouloir ce qu’on veut et vouloir ce qu’on ne veut pas (prop. 39, 40, 41, 42, 43 et 44, déf. 34, 36, 37, 38, 39 et 42 des affects)
- Phobies et engouements (prop. 45, 46 et 47, déf. 5 et 11 des affects)
– Chapitre 5 / Accidents et variations de la die affective (propositions 48 à 57)
- Fixations (prop. 48 et 49)
- Pressentiments (prop. 50)
- Lubies (prop. 51, déf. 27 des affects)
- Emballements (prop. 52, déf. 4, 5, 10, 40, 41 et 42 des affects)
- Soucis et préférences (prop. 53, 54 et 55, déf. 25 et 26 des affects)
- Déduction des comportements affectifs occasionnels et définition générale des affects passifs (prop. 56, déf. 45, 46, 47, 48 des affects, déf. générale des affects)
- Disparité des expériences affectives individuelles (prop. 57)
– Chapitre 6 / Les affects actifs (propositions 58 et 59)
– Répertoire des principales figures de l’affectivité
– La troisième partie de l’Éthique en abrégé
Introduction à l’Éthique de Spinoza. La quatrième partie : la condition humaine, de Pierre Macherey
4è de couverture
Depuis que l’Éthique a été publiée, en 1677, les idées de Spinoza ont suscité, selon les orientations les plus diverses, un intérêt qui ne s’est jamais relâché. Mais ces idées, le plus souvent, ont été considérées pour elles-mêmes, indépendamment du contexte démonstratif qui soutient leur exposition, en raison du caractère extrêmement technique et de l’aridité de celui-ci.
Dans le présent ouvrage, qui devrait servir d’outil de travail à ceux qui cherchent à avoir un accès plus direct au texte, sont proposées les explications indispensables à une lecture suivie de la quatrième partie de l’Éthique, où est abordée, sur des bases dégagées dans les trois parties précédentes (I. La nature des choses ; II. La réalité mentale ; III. La vie affective), la problématique proprement éthique pour laquelle l’ensemble du livre a été écrit. Sous l’intitulé « De la servitude humaine et des forces des affects », Spinoza procède à un examen objectif de la condition humaine appréhendée dans ses limites, ses dispositions et ses , aspirations, de manière à esquisser la dynamique pratique qui permet d’amorcer le mouvement conduisant de la servitude à la liberté : sont ainsi ouvertes les voies de la libération, qui seront examinées dans la cinquième et dernière partie du livre.
Sommaire
– Avant-propos
– Sujet et composition du de Servitute : La servitude humaine ; Le bien et le mal ; De la servitude à la liberté.
– Les principes fondamentaux
Les définitions
L’axiome
—
- Première partie - Les hommes tels qu’ils sont
– Chapitre I / Les forces des affects (propositions 1 à 18)
Ce que les idées fausses ont de positif (prop. i)
L’homme, partie de la nature (prop. 2, 3 et 4)
La servitude passionnelle (prop. S, 6 et 7)
Les formes spontanées de la connaissance du bien et du mal (prop. 8)
Les différentes catégories d’affects et les différentes forces des affects qui leur correspondent (prop. 9, 10 , 11, 12 et 13)
L’impact de la connaissance vraie du bien et du mal sur le déroulement de la vie affective et les dilemmes de la belle âme (prop. 14, 15, 16 et 17)
Le penchant à agir par plaisir (prop. 18)
Parenthèse finale : rien n’est plus utile à l’homme que l’homme (scolie de la prop. 18).
– Chapitre 2 / La vertu (propositions i9 à 28)
Le désir, loi naturelle de toutes les actions humaines (prop. 19)
L’intérêt vital, forme par excellence de la vertu (prop. 20, 21 et 22)
Agir absolument par vertu sous la conduite de la raison (prop. 23 et 24)
L’intérêt vital, principe absolu d’autonomie (prop. 25)
Le vrai bien est de comprendre un maximum de choses (prop. 26, 27 et 28)
– Chapitre 3 / Vers la société (propositions 29 à 37)
Les bases objectives de l’existence communautaire (prop. 29, 3o et 31)
Les conflits interhumains (prop. 32, 33 et 34), 184 L’accord entre les hommes (prop. 35, 36 et 37)
—
- Deuxième partie - Les conditions d’une rationalisation de l’existence humaine
– Chapitre 4 / Ce que les affects humains ont de bon et de mauvais (propositions 38 à 58)
Ce qui est utile à l’homme (prop. 38, 39 et 40)
La valeur éthique comparée des principaux sentiments humains (prop. 41 à 58)
– Chapitre 5 / Vers une rationalisation des appétits humains (propositions 59 à 66)
Les conduites humaines et leurs motivations (prop. 59)
Le contrôle des désirs (prop. 60 et 61)
Une autre manière de voir les choses (prop. 62)
Connaissance du bien et connaissance du mal (prop. 63 et 64)
L’effort en vue d’obtenir davantage de bien pour moins de mal (prop. 65 et 66)
– Chapitre 6 / La vie des hommes libres (propositions 67 à 73)
Une méditation de la vie et non de la mort (prop. 67)
Par-delà le bien et le mal (prop. 68)
La prudence (prop. 69)
Les rapports avec autrui (prop. 70 et 71)
La droiture (prop. 72)
L’engagement communautaire (prop. 73)
– La quatrième partie de l’Éthique en abrégé
Introduction à l’Éthique de Spinoza. La seconde partie : la réalité mentale, de Pierre Macherey.

– Broché : 424 pages
– Editeur : Presses Universitaires de France - PUF (1997)
– Collection : Les Grands Livres de la Philosophie
4è de couverture
Depuis que l’Éthique a été publiée, en 1677, les idées de Spinoza ont suscité, selon les orientations les plus diverses, un intérêt qui ne s’est jamais relâché. Mais ces idées, le plus souvent, ont été considérées pour elles-mêmes, indépendamment du contexte démonstratif qui soutient leur exposition, en raison du caractère extrêmement technique et de l’aridité de celui-ci.
Dans le présent ouvrage, qui devrait servir d’outil de travail à ceux qui cherchent à avoir un accès plus direct au texte, sont proposées les explications indispensables à une lecture suivie de la deuxième partie de l’Éthique, où est abordée, sous l’intitulé « De la nature et de l’origine de l’âme », l’étude rationnelle de l’âme humaine. Selon la caractérisation qu’en donne Spinoza, la nature de l’âme s’inscrit comme l’une de ses déterminations dans le contexte global d’une réalité mentale dont l’ordre est susceptible d’être appréhendé pour lui-même selon les rapports de nécessité qui le constituent intrinsèquement : ceci amène à présenter l’âme comme une idée qui, considérée dans son être objectif, est idée de corps, l’idée du corps, ainsi disposée à diverses formes d’activité qui rentrent toutes dans le cadre de la production d’idées, c’est-à-dire de la connaissance au sens large, avec ses différents genres que sont l’imagination, la connaissance abstraite et la science intuitive. La deuxième partie de l’Éthique, qui détient une position clé dans le déroulement du projet libératoire auquel est consacré l’ensemble de l’ouvrage, propose donc pour l’essentiel une analyse des conditions nécessaires dans lesquelles se déroule l’activité mentale, à laquelle elle restitue sa dimension pratique, voire même vitale, ce qui place cette analyse largement en rupture avec les traditionnelles « théories de la connaissance ».
Sommaire
– Avant-propos
– Sujet et composition du de Mente : La transition de la première à la deuxième partie de l’Éthique ; L’âme ; Les grandes articulations du de Mente.
– Notions et principes de base
Les définitions
Les axiomes
—
- Première partie - L’âme, idée du corps
– Chapitre 1 / De Dieu à l’âme humaine (propositions 1 à 13)
La pensée et l’étendue (prop. 1 et 2)
L’idée de Dieu (prop. 3 et 4)
L’ordre des idées (prop. 5, 6 et 7)
Idées de choses singulières existantes et non existantes (prop. 8 et 9)
L’âme humaine, idée d’une chose singulière existant en acte qui est le corps (prop. 10, 11, 12 et 13)
– Chapitre 2 / Des corps en général et du corps humain en particulier (développement inséré entre les propositions 13 et 14)
Les corps les plus simples (ax. 1 et 2, lemmes 1, 2 et 3, ax. 1a et 2a)
Les corps composés et les figures individuées des choses existantes (définition, ax. 3, lemmes 4, 5, 6 et 7)
Le corps humain (postulats 1 à 6)
—
- Deuxième partie - Les formes de l’activité pensante
– Chapitre 3 / La connaissance immédiate (propositions 14 à 31)
Les mécanismes de l’imagination (prop. 14 à 23)
La complexité des opérations primordiales de l’âme humaine (prop. 14 et 15)
Les conditions de la formation des idées des choses extérieures (prop. 16)
Le caractère hallucinatoire de la perception (prop. 17)
La mémoire (prop. 18)
La représentation mentale du corps (prop. 19)
La connaissance de l’âme humaine (prop. 20, 21, 22 et 23)
La connaissance inadéquate (prop. 24 à 31)
– Chapitre 4 / La connaissance rationnelle (propositions 32 à 47)
Erreur et vérité (prop. 32, 33, 34, 35 et 36)
Les notions communes (prop. 37, 38 et 39)
Les trois genres de connaissance (prop. 40, 41, 42 et 43)
La connaissance adéquate (prop. 44, 45, 46 et 47)
– Chapitre 5 / De la connaissance à l’action : vouloir et comprendre (propositions 48 et 49)
– La deuxième partie de l’Éthique en abrégé
Introduction à l’Éthique de Spinoza. La première partie : la nature des choses, de Pierre Macherey.
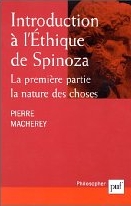
– Broché : 358 pages
– Editeur : Presses Universitaires de France - PUF
– Collection : Les grands livres de la philosophie (1998) ; Philosopher (2001)
4è de couverture
Depuis que l’Éthique a été publiée, en 1677, les idées de Spinoza ont suscité, selon les orientations les plus diverses, un intérêt qui ne s’est jamais relâché. Mais ces idées, le plus souvent, ont été considérées pour elles-mêmes, indépendamment du contexte démonstratif qui soutient leur exposition, en raison du caractère extrêmement technique et de l’aridité de celui-ci.
Dans le présent ouvrage, qui devrait servir d’outil de travail à ceux qui cherchent à avoir un accès plus direct au texte, sont proposées les explications indispensables à une lecture suivie de la première partie de l’Éthique, où est abordée sous l’intitulé « De Dieu », l’étude raisonnée de l’ensemble de la réalité considérée à partir du principe rationnel et causal qui lui confère à la fois son unité interne et son caractère d’absolue nécessité. Cette partie de l’ouvrage de Spinoza, que sa relative brièveté rend particulièrement difficile et énigmatique joue un rôle essentiel dans son économie d’ensemble : c’est elle qui donne ses bases objectives au projet de libération éthique, qu’elle enracine en profondeur dans la nature des choses.
Sommaire
– Avant-propos
– Sujet et composition du de Deo : La vraie connaissance de Dieu ; L’ordre géométrique ; Nature et puissance
– Notions et principes de base
Les définitions
Les axiomes
—
- Première partie - La nature divine (que Dieu est et ce qu’il est)
– Chapitre 1 / Substance et attributs (propositions 1 à 10)
– Chapitre 2 /Les caractères généraux de l’Être divin (propositions 11 à 15)
Nécessité de l’existence de Dieu (prop. 11)
Indivisibilité de la substance (prop. 12 et 13)
Unicité de l’Être absolu divin (prop. 14)
Globalité de l’Être divin dont l’envergure infinie contient par définition toutes choses (prop. 15)
—
- Deuxième partie - La puissance divine (ce que Dieu fait étant donné ce qu’il est)
– Chapitre 3 / La nature naturante (propositions 16 à 20)
L’agir divin, conséquence nécessaire de l’être divin (prop. 16)
Dieu, cause de toutes choses (corollaires 1, 2 et 3 de la proposition 16, proposition 17 avec ses deux corollaires, proposition 18)
L’omnipotence divine (scolie de la proposition 17)
Éternité de l’agir divin dans tous les genres d’être qui constituent la nature divine (propositions 19 et 20, avec ses deux corollaires)
– Chapitre 4 / La nature naturée (propositions 21 à 29)
Les modes infinis (prop. 21 à 23)
Les modes finis (prop. 24 à 29)
– Chapitre 5 / L’ordre des choses (propositions 30 à 36)
Autonomie et spontanéité de l’action divine, qui ne peut avoir été préméditée ou décidée arbitrairement (prop. 30 à 32)
Perfection de l’action divine qui s’effectue par sa propre nécessité interne (prop. 33 à 36)
– Chapitre 6 / Le finalisme (Appendice)
Une enquête concernant les préjugés humains
Genèse de l’illusion finaliste
Les causes finales
Les dieux
La superstition
Fausseté du finalisme
Les contradictions du finalisme
Dialogue fictif avec un finaliste
Le point de vue de l’imagination et les jugements de valeur
– La première partie de l’Éthique en abrégé
– Le réseau démonstratif de l’Éthique